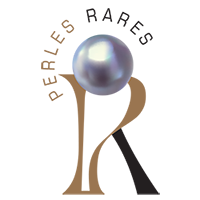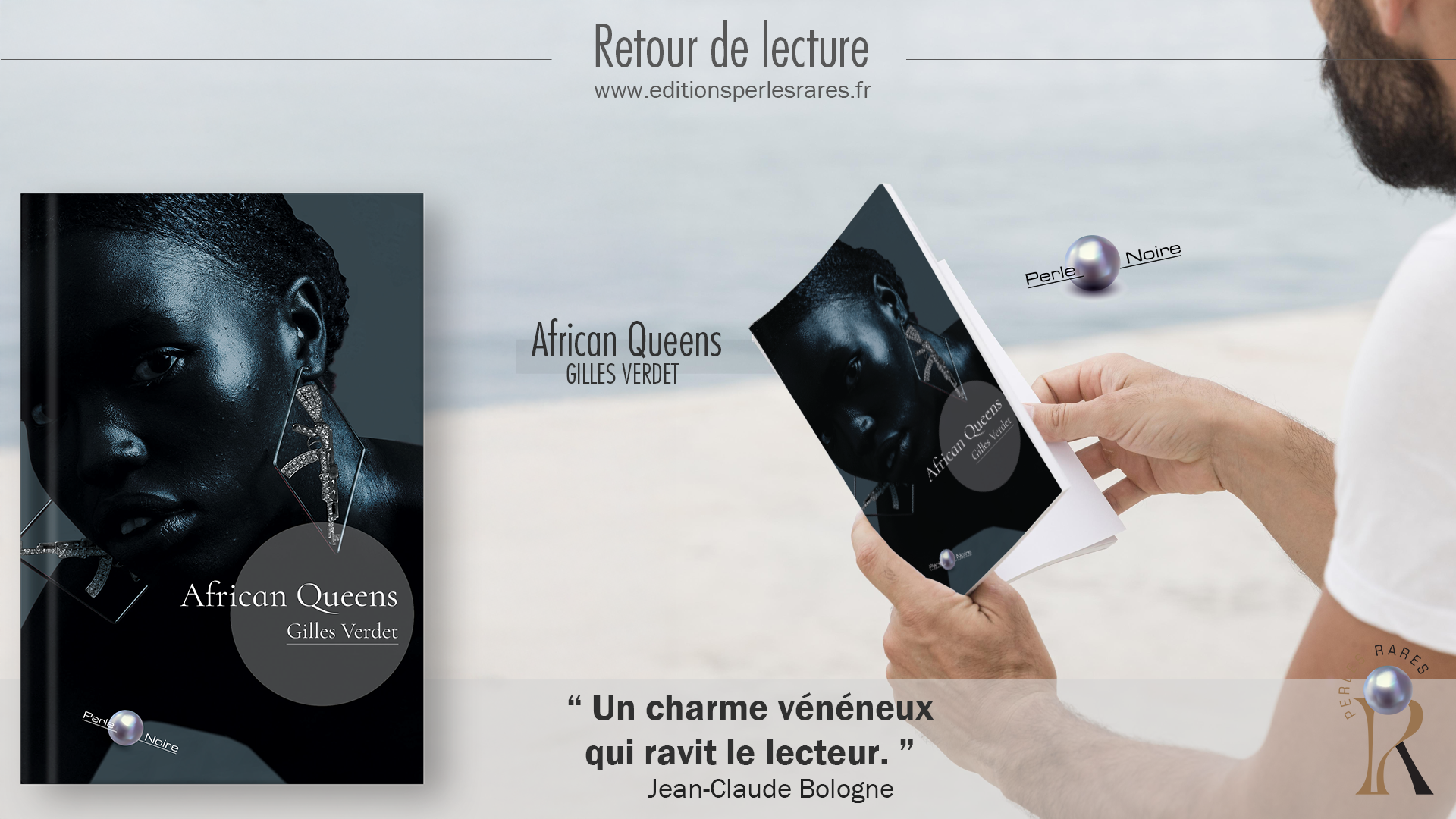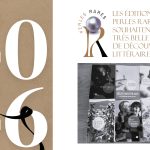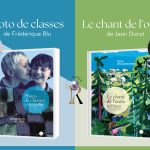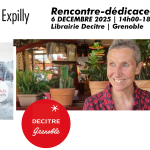Retour de lecture sur le roman « African Queens » de Gilles Verdet.
« Le destin est un voyou. Une gouape sans foi ni loi. Il aime à manigancer, à pêle-mêler les vies. À mixionner l’aubaine et l’impondérable. » Ça tombe bien : Gilles Verdet aussi. Dans l’écriture comme dans l’intrigue, chaque page a sa surprise. C’est ce qui rend ses romans originaux et terriblement séduisants. Au départ, on s’imagine dans un roman policier traditionnel, avant que les conventions ne volent en éclat. Le narrateur est ce que le politiquement correct appelle un « prête-plume », un « auteur fantôme », enfin tout ce qui nous éloigne de la vieille et péjorative appellation de « nègre ». Le personnage de Giles Verdet ne la boude pas, avec une insistance presque complaisante : « Nègre. Je suis nègre. Un bon nègre. » Mais il faut surtout y voir un trait d’humour, la plupart des personnages étant noirs de peau. L’expression « bon nègre » en prend alors un terrible double-sens. Et – clin d’œil au genre policier –, il lui préfère d’emblée l’expression « auteur à gages » !
Un écrivain public, donc, qui vit de la mode nombriliste des biographies de particuliers plus ou moins importants. C’est à ce titre qu’un politicien africain de haut vol lui propose de mettre en forme ses souvenirs consignés sur un lot de cassettes audio. Le classique travail d’un « scribouillard docile à faire briller l’ego boursouflé d’handicapés de l’écriture ». Mais au milieu de ces monologues oscillant entre panégyrique et règlement de compte, une cassette incongrue, manifestement intégrée par erreur dans la série, contient un dialogue véhément. Problème, la conversation est « en version originale, sans les sous-titres », en fait en fongbé, une langue de communication utilisée entre différents pays d’Afrique occidentale.
Le lecteur affriolé imagine aussitôt des révélations fracassantes sur le commerce international, les liens économiques entre l’Afrique et la France, la corruption, les trafics illégaux et juteux… D’autant que tous les rebondissements classiques du roman policier donnent à ce détail une ampleur démesurée : coups de fils anonymes, cambriolage, agression, assassinats… Notre auteur à gages sera-t-il à la hauteur ? Sa candeur parfois nous déconcerte. Et ce qu’il découvre est à la fois bien plus banal, hélas, et bien plus tragique, hélas. Avec l’aide d’une amie journaliste et débrouillarde, il se lance dans une enquête étonnante qui nous entraîne sur le terrain social plus que politique. Je me garderai d’en dévoiler davantage.
Ce jeu sur les codes du roman policier est une des forces du roman, ainsi que les petites touches qui suffisent à évoquer une atmosphère, les « débordements hormonaux saisonniers » de la météo ou l’ambiance des bars dont les miroirs se renvoient l’un à l’autre, « là où la vie se répétait à l’infini des apparences. Là où les vieux clients accoudés gardaient l’attention flottante des absents et le verbe discret des gens d’ailleurs. » Mais également une écriture aussi diversifiée que riche en inventions. Une scène de crime particulièrement sanglante est évoquée avec légèreté – « Son crâne fuyait comme un panier percé ». Un novice dans l’art subtil du chantage n’est qu’un « maître chanteur sans partition ». Une allusion littéraire égaie par-ci par-là l’atmosphère : du sang rouge sur la peau noire éveille « un petit soupir pour Stendhal ». Quant aux rendez-vous dans un café, ils ne peuvent se tenir qu’au Rostand, à cause de Cyrano…
Les familiers de Gilles Verdet connaissent ce ton primesautier pour évoquer des crimes sordides. Mais on trouve en plus, ici, une adaptation parfois désopilante de l’écriture aux situations. Car le narrateur, ne l’oublions pas, est un prête-plume, orfèvre en clichés éculés. Et lorsqu’il met en forme le récit du diplomate africain – manière élégante de faire avancer le récit –, il enfile les stéréotypes comme un collier de perles : « Le souffle brûlant de l’harmattan, l’alizé maléfique venu du désert, apporte chaque année son lot de calamités… » Narrateur ? Pas toujours, d’ailleurs.
Gilles Verdet n’hésite pas à rompre la règle tacite du point de vue unique sur le récit. Il passe du « je » au « il » sans vergogne, et son écriture du coup s’adapte à ce volte-face. Cette désinvolture apparente sur des sujets d’une extrême gravité – car il est question ici de l’exploitation esclavagiste en plein Paris, sujet régulièrement dénoncé par l’actualité – donne au roman un charme vénéneux qui ravit le lecteur. »
Jean-Claude Bologne | Chronique
Retrouvez la chronique complète ICI